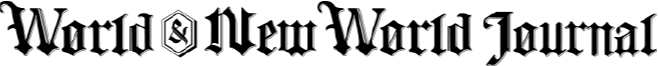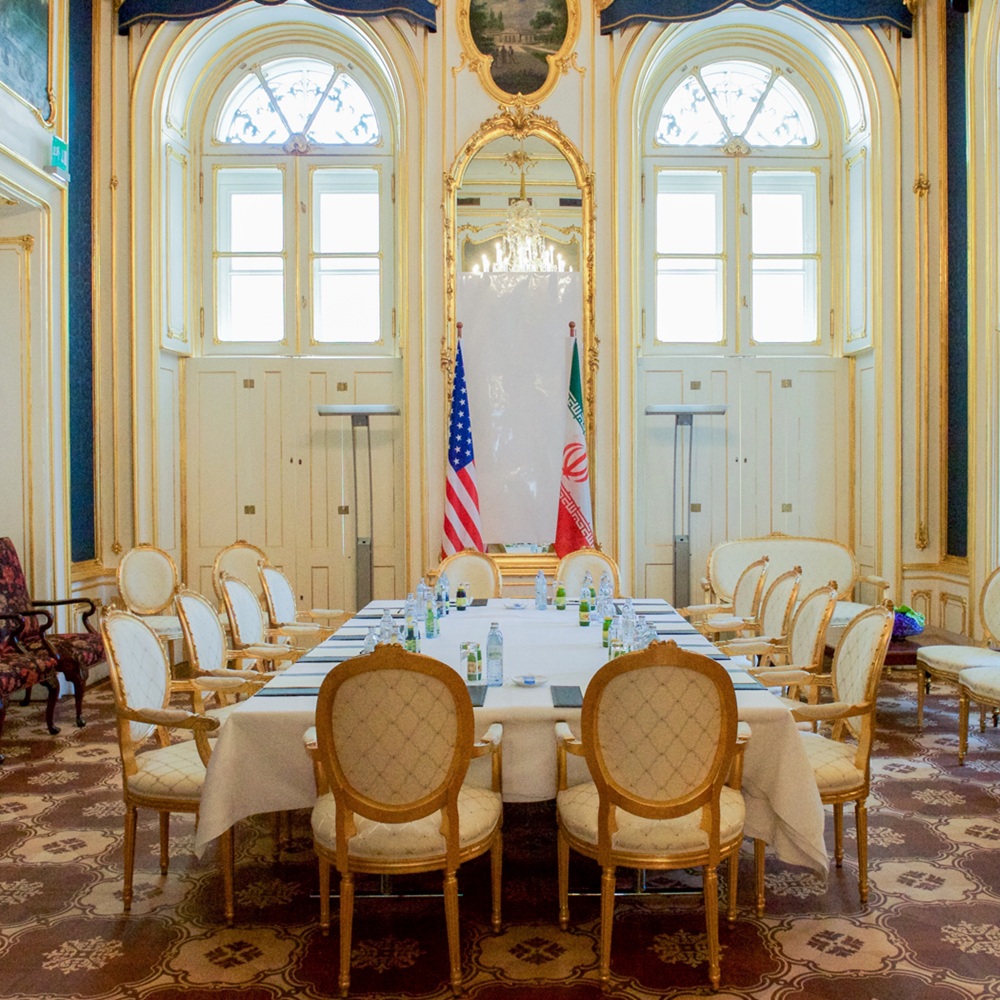Excellences,
Président de la Société des Nations Unies Modèle de Malte,
Gestionnaire de la Conférence,
Participants,
Permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers les organisateurs de cette Conférence pour m'avoir invité à prononcer ce discours, ainsi que pour avoir orchestré une discussion sur un sujet d'une grande pertinence et actualité. Je tiens également à adresser mes félicitations à Leurs Excellences pour les présentations très édifiantes qu'elles viennent de présenter devant cette assemblée.
Le thème de cette Conférence vise à explorer les réflexions relatives au progrès et à sa durabilité. Je suis d'avis que la question du progrès et du développement constitue un défi fondamental à l'heure actuelle. Nous sommes en quête de solutions pour gérer le progrès de manière équitable et équilibrée.
Pour que le progrès puisse être durable, il est impératif de garantir qu'il s'accompagne de la mise en pratique équitable du partage des avantages tout autant que des responsabilités. En d'autres termes, le progrès ne peut s'accomplir qu'à travers des moyens justes et équitables.
Permettez-moi, dans un premier temps, d'affirmer que le véritable et durable progrès ne peut être réalisé que dans le cadre d'un système international fondé sur des règles, bâti sur l'engagement et le respect mutuel. Comme l'illustre l'histoire depuis la création des Nations Unies à la suite de la Seconde Guerre mondiale, un ordre international basé sur des règles représente la seule alternative juste à un système où la puissance prévaut sur le droit.
Cette vision occupe le cœur même du système des Nations Unies, qui promeut le respect du droit international ainsi que les principes de souveraineté et d'autodétermination en tant que fondements essentiels de la diplomatie mondiale.
"Préserver les générations futures de l'horreur de la guerre."
Tels sont les premiers termes de la Charte des Nations Unies. Ces mots demeurent la principale source d'inspiration qui sous-tend le travail des Nations Unies.
Presque huit décennies plus tard, je m'alarme de constater que l'intégrité de cette vision est sérieusement mise en péril par le retour de la rivalité entre grandes puissances.
L'année écoulée a été une démonstration pratique de ce à quoi ressemble la "realpolitik". L'agression insensée et illégale ainsi que la violence implacable déchaînées en Ukraine constituent une menace directe pour les principes cardinaux du respect de la souveraineté et de l'autodétermination.
Ces événements nous ont malheureusement confrontés aux conséquences très graves de la guerre, y compris une guerre en Europe. C'est quelque chose que l'Europe avait égoïstement cru relégué au passé, car en réalité, au fil des années, il y avait toujours une guerre en cours quelque part sur la planète. Malheureusement, à de nombreuses reprises, nous nous disculpions de toute responsabilité en nous convainquant que "cela ne nous concerne pas".
Notre message collectif doit être clair et retentissant. Nous ne pouvons pas revenir à un monde où les puissants font ce qu'ils veulent et où les faibles sont laissés à subir ce qu'ils doivent.
Nous ne pouvons pas accepter que les principes fondamentaux du respect de la souveraineté et de l'autodétermination soient balayés par l'agression et la puissance militaire, que ce soit à notre porte en Ukraine, plus loin au Yémen, en Syrie, en Afghanistan ou de l'autre côté du monde.
À cet égard, la neutralité de Malte telle qu'elle est consacrée dans notre constitution n'implique en aucun cas l'indifférence face aux attaques contre nos principes partagés, à la perte déplorable de vies lors des conflits et aux souffrances infligées aux civils innocents, qu'il s'agisse de la famine, des pénuries alimentaires, des déplacements forcés ou des atrocités de la guerre, sans oublier la violence sexuelle contre les femmes. Notre Constitution ne tolère en aucune manière cette indifférence.
En effet, notre désir de siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2023-2024 découle précisément de notre forte volonté de contribuer de manière significative au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Avec l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité est pratiquement l'organe suprême des Nations Unies. Il traite des questions politiques les plus sensibles qui pourraient surgir.
Notre mandat arrive à un moment où le Conseil est fortement polarisé, notamment en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Malgré ce climat tendu, Malte demeure engagée et déterminée à poursuivre son rôle constructif dans la préservation de l'ordre fondé sur des règles et à veiller à ce que nos institutions mondiales restent pertinentes dans le monde contemporain.
Nous continuerons à plaider pour l'importance de la responsabilité conformément au droit international, ainsi que pour la lutte contre l'impunité, y compris en ce qui concerne le crime d'agression.
Excellences,
Chers amis,
Conscients de la répartition inégale des richesses et des ressources, notamment de l'accroissement continu du fossé entre les pays riches consommateurs et les pays en développement, nous détenons la clé pour promouvoir un programme de progrès équitable fondé sur les objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030.
"Laisser personne de côté" est le principe central et la promesse transformative de l'Agenda 2030 pour le développement durable.
Le dixième objectif de développement durable vise à réduire les inégalités au sein des pays et entre eux.
Dans le cadre de cet objectif, tous les États membres des Nations Unies s'engagent à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, à mettre fin à la discrimination et à l'exclusion, et à réduire les inégalités qui laissent des personnes en arrière.
Un rapide coup d'œil autour de nous indique que, parallèlement à la mondialisation et aux promesses d'amélioration du développement, la pauvreté, les difficultés économiques et les inégalités, tant au sein des pays qu'entre eux, persistent malheureusement.
À mesure que la date butoir des objectifs de développement durable se rapproche, les progrès réalisés en leur faveur sont dangereusement en décalage.
Ces objectifs étaient censés être atteints d'ici 2030, c'est-à-dire dans seulement sept ans. Pouvons-nous les atteindre en si peu de temps ?
Une série de chocs et de crises internationaux, notamment la pandémie de coronavirus, la guerre en Ukraine et l'aggravation de l'urgence climatique, ont provoqué et continuent de provoquer davantage de perturbations et de déplacements, mettant en lumière les iniquités et les injustices de l'économie mondiale.
De nombreux pays sont confrontés à une dette croissante, à des taux d'intérêt élevés, ainsi qu'à une pauvreté et à une faim croissantes, en plus des conflits internes pour satisfaire la soif insatiable du pouvoir.
Plus près de chez nous, la Méditerranée reste un foyer d'instabilité et de disparités politiques, économiques et sociales importantes.
Malheureusement, la situation politique et économique dans notre voisinage immédiat continue de se dégrader ; le phénomène de la migration irrégulière, la menace existentielle posée par le changement climatique et les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire nous fournissent des exemples clairs de ce qui nous attend.
À l'échelle mondiale, les pays à revenu faible et intermédiaire sont vulnérables et exposés aux crises politiques, économiques et écologiques qui ne dépendent pas d'eux.
De nombreux petits États insulaires font face à de graves menaces pour leur existence en raison de l'émigration progressive de leur population due au changement climatique et à la probabilité d'une élévation future du niveau de la mer.
Pendant ce temps, les populations vulnérables, les personnes vivant dans la pauvreté ou marginalisées en raison de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur religion ou de leur nationalité, ont toutes besoin de solutions pratiques, centrées sur les personnes et humaines pour résoudre des problèmes mondiaux tels que le changement climatique ou la pandémie.
Ces défis sont multiples et transnationaux, c'est pourquoi il est nécessaire qu'ils soient résolus par la coopération internationale et un système multilatéral réactif.
À la base, des millions de personnes à travers le monde continuent d'appeler à un accès égal à la santé, à la nutrition, à l'éducation, à l'énergie et à la mobilité. Des choses de base auxquelles, malheureusement, elles n'ont toujours pas accès.
Ces appels passionnés et sincères en faveur de la justice sociale ne doivent pas être ignorés.
Nous devons, et je le dis très responsabilité, éviter de nous installer dans une mentalité "occidentalisée", ou pire encore de devenir trop "eurocentriques" dans nos évaluations, en pensant que le monde est le même qu'en Europe ou en Occident. Il y a bien plus au-delà de cette mentalité occidentale et de cette eurocentricité.
Aussi étrange que cela puisse paraître, l'égalité des sexes s'éloigne de plus en plus à travers le monde, avec des projections indiquant que cela ne sera atteint, le cas échéant, que dans de nombreuses années. Les progrès en matière de santé maternelle et d'accès à une éducation de qualité pour les jeunes filles restent désespérément faibles.
La logique est simple : sans la contribution de la moitié dépossédée de la population mondiale, nous ne pourrons réaliser que la moitié de notre potentiel, voire moins.
Jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, quelle que soit leur race, leur confession ou leur couleur, nous sommes tous des partenaires égaux dans cet effort mondial visant à promouvoir des sociétés justes censées répondre aux besoins fondamentaux des citoyens.
Lorsque je parle de besoins, j'inclus des considérations telles que l'importance d'avoir - des choses simples - un accès à une énergie propre et efficace, à des services de santé et d'éducation de qualité, et à des opportunités d'emploi rémunérateur. Ce ne sont là que quelques-uns des ingrédients de base nécessaires.
Nous devons réaliser que l'exclusion politique de groupes au sein de nos sociétés par le biais de la xénophobie, du racisme, de l'intolérance et de la déshumanisation empêche des résultats équitables et détruit la cohésion sociale, entraînant des tensions, des troubles et peut-être même des conflits ouverts.
Nous devons édifier des sociétés et des communautés inclusives, ainsi qu'un ordre international fondé sur la justice. Dans de telles sociétés, chaque être humain devrait vivre dans la dignité et le respect, et mener une vie qui a du sens et qu'il chérit.
Les femmes, les jeunes, les groupes ethniques, religieux et toute la société civile doivent tous être habilités de manière égale à participer de manière significative aux décisions qui influent sur leur vie. C'est une condition fondamentale pour la justice sociale.
Excellences,
Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que nous sommes tous d'accord pour dire que nous sommes loin de remplir notre devoir collectif de garantir un avenir plus équitable pour les générations à venir.
La question est donc la suivante : "Que pouvons-nous faire à ce sujet ? Comment pouvons-nous passer de l'état actuel des choses aux sociétés justes et équitables que nous aspirons tous à créer ?"
L'homme a toujours rêvé d'une "utopie". Nous savons qu'elle n'est pas atteignable, mais nous devrions continuer à essayer, du moins.
Je crois personnellement que les jeunes ainsi que l'éducation jouent un rôle crucial à cet égard.
Pour citer la célèbre éducatrice Maria Montessori : "Établir une paix durable est l'œuvre de l'éducation. Tout ce que la politique peut faire, c'est nous empêcher de faire la guerre."
Cela ne signifie pas que nous, en tant que dirigeants politiques, n'avons aucune obligation en la matière. Bien au contraire.
Nos obligations, qu'elles soient individuelles ou collectives, consistent à promouvoir une éducation inclusive qui favorise la dignité de chaque être humain et qui reconnaît les valeurs de compréhension, de dialogue, ainsi que de solidarité.
L'éducation sensibilise à l'environnement, encourage la tolérance envers les opinions des autres, favorise l'acceptation du fait que nous formons une seule race humaine, et promeut la paix fondée sur la justice, l'amour et le respect d'autrui.
Cela est essentiel si nous voulons construire des sociétés socialement justes qui font du progrès le moyen d'assurer un avenir plus équitable.
Pour l'avenir, je suis persuadé que l'éducation est un instrument clé pour autonomiser notre jeunesse.
L'autonomisation des jeunes a été un thème récurrent tout au long de ma présidence.
Les jeunes du monde entier ont un rôle crucial à jouer pour favoriser le dialogue ouvert, rechercher des points communs et contribuer à des changements positifs au sein de nos sociétés.
C'est pourquoi, en 2016, j'ai été animé par la volonté d'initier le programme "Jeunes Voix de la Méditerranée", en partenariat avec l'ancienne Haute Représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, et la Fondation Anna Lindh, basée à Alexandrie.
Lors de cette initiative, plus de 600 étudiants originaires de toute la région méditerranéenne, du Moyen-Orient et du Golfe ont mis de côté leurs différences pour promouvoir une culture de persuasion plutôt que de confrontation, de tolérance plutôt que de condamnation, et d'acceptation plutôt que d'exclusion.
Des institutions telles que la Fondation Anna Lindh continuent à promouvoir de telles approches inclusives pour les jeunes. Aujourd'hui, la Méditerranée abrite des millions de jeunes voix désireuses de développer leur plein potentiel et de contribuer à la construction de sociétés durables et inclusives.
Cependant, il est important de rappeler que la Méditerranée ne représente qu'une petite portion du globe. Les Nations Unies ont un rôle essentiel à jouer sur l'ensemble de la planète.
Ces réflexions initiales, je l'espère, vous seront utiles au cours de vos débats et réflexions.
Je vous encourage tous à tirer le meilleur parti des enseignements que vous retirerez de cette Conférence, car ce que vous y apprendrez pourrait bien influencer le cours de votre vie dans les années à venir. Je vous souhaite des discussions fructueuses et productives.
Merci infiniment.