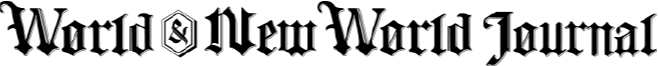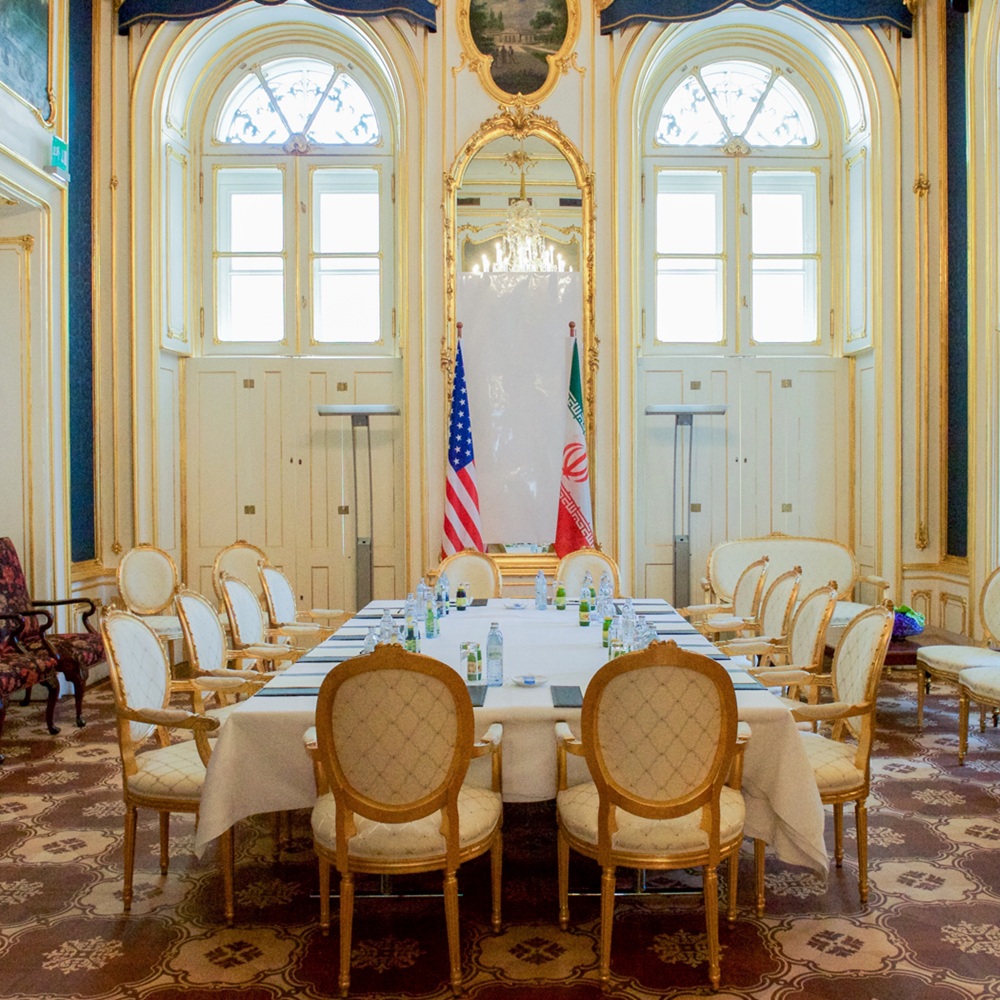Diplomacy
Ne vous laissez pas tromper par les discussions entre M. Biden et M. Xi : la relation entre la Chine et les États-Unis est davantage caractérisée par une rivalité durable que par un partenariat engagé
Image Source : Wikimedia Commons
Il y avait des sourires pour la caméra, des poignées de main, des paroles chaleureuses et la révélation de quelques accords.
Mais au-delà de l'aspect visuel de la première réunion en plus d'un an entre les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales, pas grand-chose n'avait vraiment changé : Rien n'indiquait une "réinitialisation" des relations entre les États-Unis et la Chine, qui, ces dernières années, étaient ancrées dans la méfiance et la concurrence.
Le président Joe Biden a laissé entendre cela quelques heures seulement après les pourparlers en personne, confirmant qu'il considérait toujours son homologue chinois, Xi Jinping, comme un "dictateur". Pékin a riposté, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, déclarant que la remarque de Biden était "extrêmement incorrecte et une manipulation politique irresponsable".
En tant que spécialiste des relations entre les États-Unis et la Chine, je pense que la relation entre les deux pays peut être mieux décrite comme une "rivalité durable" - un terme utilisé par les politologues pour désigner deux puissances qui se sont choisies mutuellement pour une intense compétition sécuritaire. Des exemples historiques de telles rivalités comprennent l'Inde et le Pakistan, la France et l'Angleterre, et l'Occident et l'Union soviétique. Au cours des deux derniers siècles, de telles rivalités représentent seulement 1 % des relations internationales mondiales, mais 80 % de ses guerres. L'histoire suggère que ces rivalités durent environ 40 ans et se terminent uniquement lorsque l'une des parties perd la capacité de rivaliser - ou lorsque les deux parties s'allient contre un ennemi commun. Aucun de ces scénarios ne semble probable de sitôt en ce qui concerne la Chine et les États-Unis.
Comment se termine une rivalité durable
"La Chine est un pays communiste... basé sur une forme de gouvernement totalement différente du nôtre", a déclaré Biden après sa rencontre avec Xi.
Ce commentaire touche au cœur de la raison pour laquelle la diplomatie seule ne peut pas réinitialiser les relations sino-américaines. Washington et Pékin ne sont pas des rivaux en raison d'un malentendu qui peut être résolu par des pourparlers seuls. Au contraire, ce sont des rivaux en raison de la raison opposée : ils se comprennent trop bien et sont parvenus à la conclusion que leurs perspectives mondiales respectives ne peuvent pas être conciliées.
Il en va de même pour bon nombre des questions qui divisent les deux pays - elles sont présentées comme des scénarios binaires gagnant-perdant. Taiwan peut être gouvernée depuis Taipei ou Pékin, mais pas les deux. De même, les mers de Chine orientale et du Sud peuvent être des eaux internationales ou un territoire chinois ; la Russie peut être affaiblie ou soutenue.
Pour les États-Unis, ses alliances asiatiques sont une force de stabilité ; pour la Chine, elles sont une encerclement hostile. Et les deux pays ont raison dans leurs évaluations respectives.
La diplomatie seule est insuffisante pour résoudre une rivalité. Au mieux, elle peut aider à la gérer.
Quand les États-Unis appellent, qui décroche ?
Une partie de cette gestion de la rivalité sino-américaine implique de trouver des domaines d'accord pouvant être respectés.
Et le 15 novembre, Biden et Xi ont annoncé des accords sur la limitation de la production par la Chine de la drogue mortelle qu'est le fentanyl et la reprise d'un dialogue militaire de haut niveau entre les deux pays.
Mais l'annonce sur le fentanyl ressemble beaucoup à celle que Xi avait faite à l'ancien président Donald Trump en 2019. L'administration américaine a ensuite accusé la Chine de ne pas avoir respecté l'accord.
De même, s'engager à relancer un dialogue de haut niveau est une chose ; le suivre en est une autre. L'histoire est jalonnée d'occasions où avoir une ligne ouverte entre Beijing et Washington n'a pas signifié grand-chose en temps de crise. En 2001, lorsqu'un avion de surveillance américain est entré en collision avec un jet chinois au-dessus de l'île de Hainan, Pékin n'a pas décroché le téléphone. De même, lors du massacre de la place Tiananmen, le président de l'époque, George H.W. Bush, a tenté d'appeler en urgence son homologue Deng Xiaoping mais n'a pas réussi à le joindre.
De plus, se concentrer sur ce qui a été convenu lors des pourparlers met également en lumière ce qui n'a pas été - et est peu susceptible de l'être un jour - convenu sans un changement substantiel de pouvoir qui force une partie à céder à l'autre.
Par exemple, la Chine souhaite que les États-Unis cessent de vendre des armes à Taiwan. Mais Washington n'a aucune intention de le faire, car il sait que cela rendrait l'île contestée plus vulnérable à Pékin. Washington aimerait que la Chine mette fin à ses démonstrations de force militaire dans le détroit de Taiwan ; Pékin sait que le faire risque de voir Taiwan dériver vers l'indépendance.
Les responsables américains disent depuis longtemps ce qu'ils veulent, c'est que la Chine "change" - ce qui signifie libéraliser son système de gouvernance. Mais le Parti communiste chinois sait que le faire signifie l'auto-liquidation - chaque régime communiste qui a laissé de l'espace pour des partis politiques alternatifs s'est effondré. C'est pourquoi les tentatives américaines de dialoguer avec la Chine sont souvent accueillies avec suspicion en Chine. Comme l'a commenté l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin, les politiques d'engagement et de containment ont le même objectif : mettre fin au système socialiste de la Chine.
Pour des raisons similaires, Xi a rejeté les tentatives des États-Unis de faire davantage entrer la Chine dans l'ordre international fondé sur des règles. Le leader chinois a vu ce qui s'est passé lorsque le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev a tenté d'intégrer l'Union soviétique dans l'ordre occidental à la fin des années 1980 - cela n'a fait qu'accélérer la disparition de l'entité socialiste.