Defense & Security
La politique étrangère et de défense française face à la guerre en Ukraine

Image Source : Shutterstock
Subscribe to our weekly newsletters for free
If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter
your e-mail
Defense & Security

Image Source : Shutterstock
First Published in: Jun.23,2023
Jul.10, 2023
Après de nombreuses années de lutte contre le terrorisme islamiste, l'invasion de l'Ukraine en février 2022 a provoqué une véritable prise de conscience en France. Désormais, le pays semble davantage engagé en faveur d'un renforcement du partenariat de sécurité euro-atlantique.
Depuis 2012, la France fait face à une menace constante d'attaques terroristes islamistes. Celle-ci a atteint son paroxysme en 2015 avec les attaques meurtrières contre le journal Charlie Hebdo en janvier et au Bataclan en novembre. Ces menaces expliquent pourquoi le gouvernement français a pris la décision d'intervenir là où les terroristes sont les plus susceptibles de proliférer, dans le but de les neutraliser avant qu'ils ne parviennent en France ou dans d'autres pays européens. Les deux régions où les forces militaires françaises ont mené des opérations contre les terroristes sont le Moyen-Orient et le Sahel.
Entre-temps, les relations entre Paris et certains alliés de l'OTAN ont donné lieu à des tensions diplomatiques difficiles. "Ce que nous vivons actuellement, c'est la mort cérébrale de l'OTAN", a déclaré Emmanuel Macron à The Economist en octobre 2019. Lors de cet événement, les États-Unis ont retiré leurs forces du nord de la Syrie sans consulter au préalable l'OTAN, tandis que l'intervention turque en Syrie, un autre allié clé de l'OTAN, menaçait les intérêts américains et français sans susciter de réaction de la part de l'alliance. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a engendré des changements dans la politique étrangère et de défense de Paris, mais il est possible que ces ajustements ne soient pas encore suffisants pour faire face aux défis à venir.
Après l'épisode de la "mort cérébrale", les tensions entre la France et la Turquie se sont intensifiées et ont atteint leur apogée en juin 2020 lorsque, selon la marine française, un navire turc a pointé son radar sur les navires français lors de l'opération Sea Guardian. Cette mission était une opération de sécurité maritime de l'OTAN en Méditerranée orientale, déployée après que les Nations unies ont imposé un embargo sur les livraisons d'armes à la Libye. Une fois de plus, l'OTAN n'a pris aucune mesure pour réprimander la Turquie pour son comportement anti-alliance. Ces épisodes ne sont que deux parmi de nombreux autres témoignant des tensions récurrentes entre la France et l'OTAN.
Il est bien établi que la France entretient des relations complexes avec certains de ses alliés au sein de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide, notamment avec les États-Unis. Bien que Macron ait exprimé sa frustration face à l'inaction de l'alliance, la France a également mené des initiatives visant à contrecarrer ses propres alliés. Pour comprendre la relation parfois délicate de la France avec les États-Unis, il faut noter qu'il existe de puissants courants politiques français opposés à une prétendue hégémonie américaine. Les mouvements d'extrême gauche et d'extrême droite sont les plus évidents, mais même les conservateurs modérés peuvent adopter occasionnellement un discours rappelant celui de Charles De Gaulle dans les années 1960, prônant la sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN. Aujourd'hui, les opposants à l'"atlantisme" sont soit anticapitalistes (extrême gauche), soit souverainistes (extrême droite), soit défenseurs de l'indépendance nationale ou européenne (conservateurs). Ils partagent tous une idéologie plus ou moins opposée au libéralisme et ont tous tendance à percevoir la Russie de manière positive.
L'extrême gauche perçoit la Russie comme l'héritière de l'Union soviétique communiste, tandis que l'extrême droite et les conservateurs apprécient le discours de Poutine, qui s'oppose à l'islamisme et défend les valeurs traditionnelles. De plus, de nombreux militaires français affichent également leur soutien à la Russie. Le fort soutien en France envers les pays susceptibles de "résister à l'hégémonie américaine" peut expliquer la position initialement modérée du président Macron à l'égard de la Russie.
Ce sentiment anti-américain est renforcé par le fait que la France continue de se considérer comme un acteur majeur dans les relations internationales. Lors d'une visite en Chine en avril 2023, Macron a déclaré aux journalistes que l'Europe ne devait pas devenir le "vassal" de l'Amérique. Cette position a suscité l'exaspération de nombreux alliés en Europe, en Amérique du Nord et au Japon, et n'a en rien renforcé les capacités de défense ni l'autonomie stratégique de l'Europe, qui étaient, paradoxalement, l'un des objectifs de Macron avant sa visite en Chine.
Selon le président Macron lui-même, la guerre en Ukraine a réveillé l'OTAN de son "état de mort cérébrale". En revanche, cela semble avoir eu un effet inverse sur les ambitions françaises d'être un acteur central ou un leader européen en matière de sécurité. Les déclarations concernant les garanties de sécurité envers la Russie et le fait que la France ait relativement moins contribué à la défense de l'Ukraine comparé à certains de ses alliés, ont affaibli sa stature en Europe. C'est pourquoi Paris semble désormais prêt à collaborer plus étroitement avec l'OTAN, même si certaines incohérences nuisent encore à la clarté du message.
Trois éléments vont dans le sens d'une plus grande coopération entre la France et ses alliés membres de l'OTAN. Le premier, en réponse au discours de Macron à Bratislava en mai 2023, est la nouvelle loi de programmation militaire pour les manœuvres défensives. Le meilleur exemple de manœuvres militaires conjointes est ORION 2023, qui a débuté en 2021 et s'est achevé en mai 2023. Il s'agit des exercices les plus importants depuis trente ans pour l'armée française et ont impliqué, dans leur phase finale au printemps 2023, environ 14 alliés, y compris des jets Rafale de l'armée de l'air indienne. Avec ORION, la France a prouvé qu'elle était prête à agir en tant que nation-cadre de l'OTAN dans un scénario de guerre de haute intensité. Cela a rassuré les alliés de la France qui ont été ébranlés par les différentes déclarations du président Macron depuis 2019. Avec son retrait du Sahel, la France a enfin pu se concentrer plus sérieusement sur la sécurité européenne.
Le discours prononcé par Macron à Bratislava démontre aussi un changement dans la position française vis-à-vis de la sécurité transatlantique. Le président français a souhaité rassurer ses alliés quant au rôle de l'OTAN dans la sécurité européenne. Il n'a pas mis l'accent sur “l’autonomie stratégique", préférant souligner l'importance de devenir de meilleurs alliés avec les États-Unis. Il a même mentionné que l'agression de Vladimir Poutine en Ukraine avait redynamisé l'OTAN.
Le dernier élément concerne la décision de la France de jouer un rôle plus constructif dans la sécurité transatlantique, à savoir la loi de programmation militaire pour la période 2024-2030. À première vue, cette loi est impressionnante : avec un coût estimé à 413 milliards d'euros sur les sept prochaines années, elle porterait le budget de la défense à 69 milliards d'euros en 2030, contre 44 milliards d'euros en 2023 et 32 milliards d'euros en 2017. Cependant, le problème réside dans le fait que, tout comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, nous ne savons pas si cet argent supplémentaire renforcera véritablement les capacités militaires européennes. Dans le cas de la France et du Royaume-Uni, une grande partie du budget militaire est consacrée à la dissuasion nucléaire plutôt qu'aux besoins d'un conflit conventionnel de haute intensité comme celui de l'Ukraine.
De plus, il convient de souligner que l'inflation va absorber une part importante de ce nouveau budget. Il est donc essentiel de se poser la question de savoir si le nouveau budget de la défense renforcera réellement la capacité militaire de la France pour faire face à un conflit de haute intensité en Europe, ou s'il sera orienté vers d'autres capacités technologiques visant à projeter la puissance au-delà des frontières françaises. Seul l'avenir nous le dira. Toutefois, les alliés doivent rester vigilants quant aux actions du gouvernement français plutôt qu'à ses discours. Étant donné l'importance des mouvements politiques populistes et radicaux, ainsi que la menace constante du terrorisme, il est toujours possible de voir un retour à une politique étrangère et de défense centrée sur le pays même.
First published in :
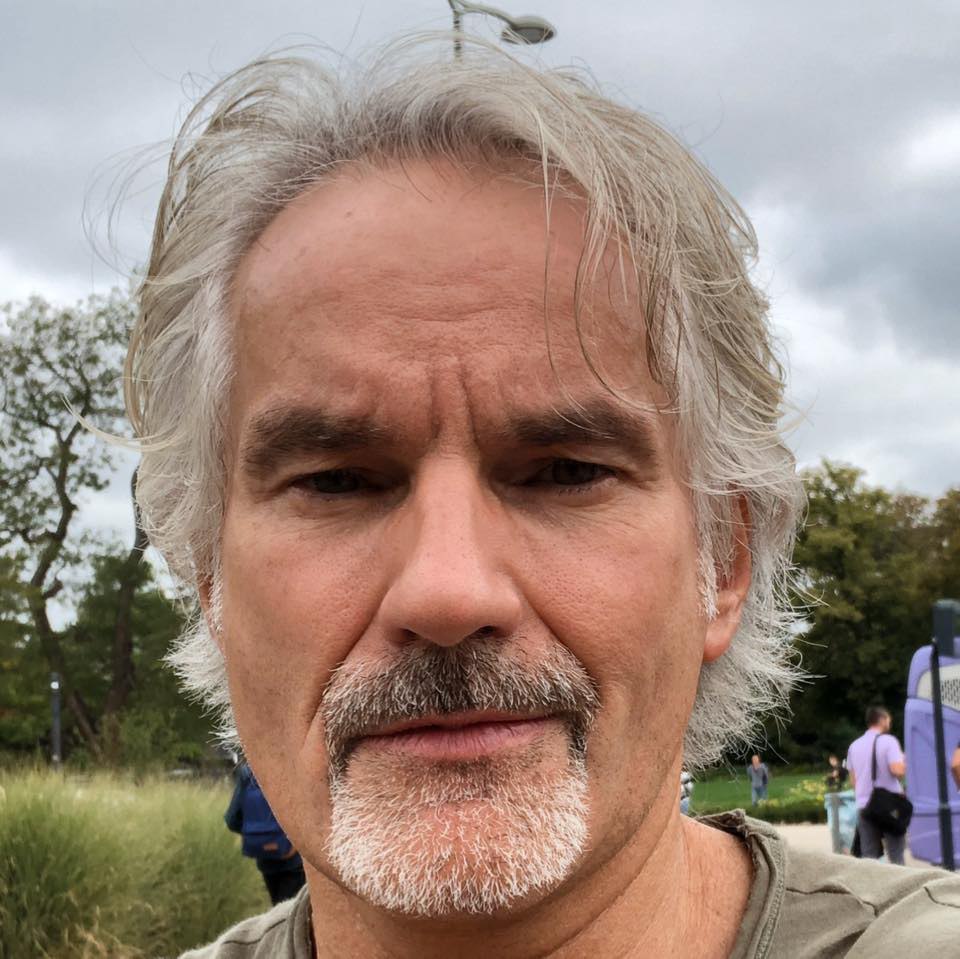
Dr. Ronald Hatto est maître de conférences en relations internationales et études stratégiques au CERI/Sciences-Po Paris. Ses domaines de recherche se concentrent sur les opérations de maintien de la paix menées par les Nations unies, la politique étrangère de la France et des États-Unis, ainsi que les relations transatlantiques. Son expérience pratique comprend sa participation à l'opération de maintien de la paix avec la Force de maintien de la paix des Nations unies à Chypre (UNFICYP).
Unlock articles by signing up or logging in.
Become a member for unrestricted reading!