Defense & Security
Le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO : les contours d'un nouvel ordre régional en Afrique de l'Ouest
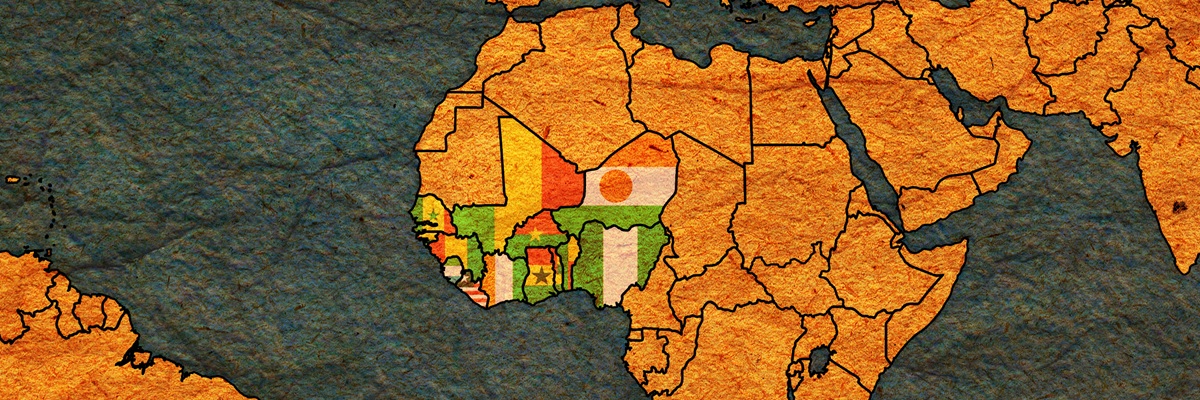
Image Source : Shutterstock
Subscribe to our weekly newsletters for free
If you want to subscribe to World & New World Newsletter, please enter
your e-mail
Defense & Security
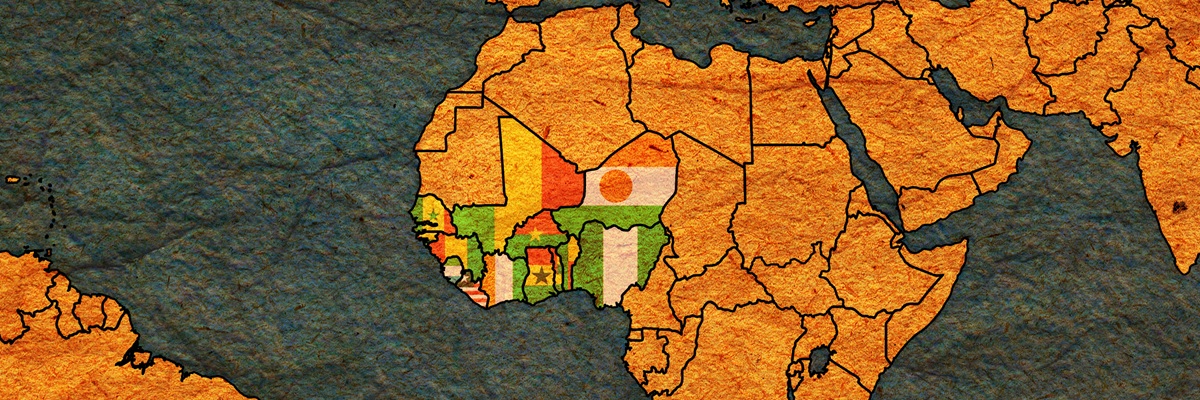
Image Source : Shutterstock
First Published in: Mar.26,2025
Apr.21, 2025
La première moitié des années 2020 a radicalement changé la situation au Sahel. Les coups d'État militaires au Mali (2021), au Burkina Faso (2022) et au Niger (2023) ont porté les militaires au pouvoir. Au Niger, la junte militaire qui a pris le pouvoir, le Conseil national pour la protection de la patrie dirigé par Abdourahamane Tiani, a dû faire face à de vives critiques, à des sanctions et à un blocus économique de facto du pays par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). En outre, la CEDEAO a menacé d'intervenir militairement, dans le but officiel de rétablir le président déchu Mohamed Bazoum. À bien des égards, le risque de nouveaux coups d'État militaires dans les pays de la région a motivé l'organisation, ce qui a particulièrement inquiété le Nigeria, qui la présidait à l'époque. Abuja se positionnait comme un leader dans la région, en particulier au sein de la CEDEAO, et il était donc important pour lui de préserver l'intégrité de l'organisation et le statu quo dans les pays voisins. La pression exercée par la France a également eu un impact. Paris a des intérêts économiques importants au Niger en raison des grandes réserves d'uranium du pays, qui alimentent les centrales nucléaires françaises.
En conséquence, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont entamé un processus de création d'une alliance militaire visant à assurer la défense commune des trois pays, y compris la lutte contre le terrorisme et le séparatisme. C'est ainsi que l'Alliance des États du Sahel (AES) a été créée le 16 septembre 2023 et transformée en confédération le 6 juillet 2024. Ainsi, la coopération entre les trois pays s'est élargie : elle couvre désormais non seulement les sphères militaro-politiques, mais aussi socio-économiques.
Dès le 28 janvier 2024, les pays de l'AES ont annoncé leur intention de quitter la CEDEAO, mais comme un retrait immédiat de l'organisation n'était pas possible, ils sont restés de façon officielle dans l'organisation pendant une année supplémentaire, au cours de laquelle les États membres de la CEDEAO ont essayé de trouver un compromis avec l'AES. Le 28 janvier 2025, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont officiellement annoncé leur retrait de la CEDEAO. Ce processus politique au Sahel modifie considérablement l'équilibre des pouvoirs dans la région.
Pourquoi les pays de l'AES se sont-ils retirés de la CEDEAO ?
Les raisons du retrait des États de l'organisation sont liées aux problèmes de séparatisme et de terrorisme dans la région. Début 2012, au plus fort de la guerre civile en Libye, des Touaregs libyens ont formé le « Mouvement national de libération de l'Azawad » (MNLA) et se sont rendus au Mali pour se rebeller contre le gouvernement et créer un État touareg indépendant. Après le coup d'État militaire au Mali en mars 2012, les rebelles ont profité de la situation pour proclamer l'« État indépendant de l'Azawad » dans le nord du pays. Ils ont été soutenus par des combattants du Front Ansar al-Din, en contact avec Al-Qaïda. Cependant, après la déclaration d'indépendance de l'Azawad, les islamistes n'ont pas accepté le statut laïc de cet État non reconnu, ce qui a entraîné des contradictions avec le MNLA. À la suite des combats entre les islamistes et les rebelles laïques, ces derniers ont été vaincus et sont devenus clandestins. L'ensemble du territoire de l'Azawad est passé sous le contrôle des islamistes radicaux.
L'islamisation du mouvement, ainsi que les attaques islamistes dans le sud du Mali, ont contraint la France à intervenir, car elle risquait de déstabiliser la situation dans la région. L'opération Serval est annoncée. La CEDEAO, en vertu de l'article 3 du Protocole d'assistance mutuelle en matière de défense, signé à Freetown le 3 mai 1981, était tenue de fournir une assistance au Mali pour les opérations antiterroristes. En conséquence, et se référant également à la résolution №2085 du Conseil de sécurité des Nations unies, la CEDEAO a lancé la Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (AFISMA). En conséquence, la France et la CEDEAO ont réussi à libérer toutes les villes capturées par les militants en février 2013, après quoi la mission de la CEDEAO a été placée sous les auspices de l'ONU. L'opération des Nations unies a été baptisée Mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et avait un caractère de maintien de la paix. Mais ces efforts n'ont pas suffi à détruire les groupes extrémistes au Mali. Les militants ont commencé à utiliser des méthodes de guérilla et une vague de terreur s'est abattue sur les villes du pays. Ni la mission de l'ONU ni la nouvelle opération française Barkhan (2014-2021) n'ont pu mettre fin à la terreur dans le pays. La situation s'est aggravée après l'apparition en 2017 d'un nouveau groupe islamiste radical, Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM), une branche régionale d'Al-Qaïda. Il a opéré non seulement au Mali, mais aussi au Burkina Faso et au Niger. Ces dernières années, les séparatistes du Front de libération de l'Azawad ont été en contact avec le JNIM, ce qui pourrait conduire à la consolidation des forces antigouvernementales et, par conséquent, renforcer davantage la position des terroristes dans le pays. Selon le Global Terrorism Index 2025, alors que le nombre de décès liés aux conflits dans le Sahel était d'environ 5 400 par an en 2017, il s'élèvera à 25 000 en 2024.
La CEDEAO et la France sont impuissantes face à cette menace. La lutte contre les guérillas insurrectionnelles exige des tactiques spéciales et beaucoup d'effectifs, mais ni la France ni la CEDEAO ne disposent de ces outils. Bien que la CEDEAO ait déployé à plusieurs reprises des troupes dans des pays en guerre (Liberia, Sierra Leone, etc.), elle n'avait aucune expérience en matière de lutte contre le terrorisme. Au Sahel, les forces de la CEDEAO ont dû faire face à des islamistes qui recouraient au sabotage et au terrorisme. En outre, la CEDEAO est avant tout une organisation visant à résoudre des problèmes économiques, de sorte que la grande majorité de ses ressources sont déployées pour résoudre des problèmes économiques plutôt que militaires. Cependant, pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, la première priorité est d'éliminer les groupes séparatistes et terroristes, c'est pourquoi ces pays donnent la priorité à la coopération en matière de sécurité au sein de l'organisation. Comme la CEDEAO n'a pas fourni une assistance suffisante en raison de son incapacité à mener à bien la mission de combat (au Burkina Faso et au Niger, la CEDEAO n'a mené aucune opération antiterroriste), les trois pays ont préféré créer leur propre alliance militaire, qui est axée sur la lutte contre le séparatisme et le terrorisme, prend en compte toutes les particularités de la lutte contre les guérillas et correspond aux intérêts communs des trois pays. C'est la raison pour laquelle les pays de l'AES se sont retirés de la Communauté économique.
Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, Premier ministre du Burkina Faso, dans sa déclaration du 30 janvier 2024, a relevé que depuis près d'une décennie, les trois pays sont confrontés à des groupes criminels soutenus, financés et équipés par leurs partenaires, dans l'indifférence de certains pays voisins et des organisations sous-régionales, dont la CEDEAO. On peut en conclure que les pays du Sahel sont désillusionnés par la politique de la CEDEAO en matière de sécurité dans la région.
Quel est l'avenir du « trio sahélien » ?
Fin janvier 2025, les pays de l'AES ont annoncé la création d'un contingent de forces conjointes de 5 000 hommes pour lutter contre le terrorisme, réalisant ainsi l'objectif principal de l'alliance militaire, à savoir l'organisation coordonnée de la lutte contre le terrorisme dans la région. Cela a rehaussé le profil des militaires au pouvoir dans les trois pays. La ligne de conduite adoptée par les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger a trouvé un écho auprès de l'opinion publique. Le 29 janvier 2025, après l'annonce officielle par le président de la Commission de la CEDEAO du retrait des pays de l'AES, les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont descendues dans la rue pour fêter l'événement. En cas de succès des opérations de lutte contre le terrorisme dans la région, le soutien populaire augmentera, ce qui contribuera à consolider le pouvoir des militaires et, par conséquent, à stabiliser la situation politique dans ces pays, au moins à moyen terme. Toutefois, pour stabiliser définitivement la situation dans la région, il est nécessaire d'éliminer la menace terroriste et de créer des forces armées fortes et prêtes au combat. La stabilisation de la situation politique, mais aussi socio-économique des pays du Sahel en dépend.
Contrairement à la sphère politico-militaire, les liens socio-économiques avec la CEDEAO demeurent. Bien que les pays de l'AES aient également quitté la CEDEAO, certaines dispositions clés de l'organisation restent en vigueur. Par exemple, selon la déclaration officielle de la CEDEAO sur le retrait des pays de l'AES datée du 29 janvier 2025, les passeports et les cartes d'identité portant l'emblème de la CEDEAO restent en place, les biens et les services des pays de l'AES ont accès au marché de la CEDEAO dans les mêmes conditions, les voyages sans visa sont maintenus et les fonctionnaires de l'AES travaillant dans les institutions de la CEDEAO sont soutenus et maintenus à leur poste. Toutefois, le même document précise que ces conditions sont temporaires. Les termes permanents de la coopération avec les trois pays seront adoptés lors d'un prochain sommet des chefs d'État.
La situation socio-économique des pays du Sahel est très difficile. Selon la Revue de la population mondiale, le pourcentage de la population en dessous du seuil de pauvreté est de 45,5 % au Niger, 44,6 % au Mali et 43,2 % au Burkina Faso. Bien que ces États soient riches en ressources naturelles, ils ne sont pas en mesure d'exploiter pleinement leur potentiel en raison de la faiblesse de leurs infrastructures. Il est nécessaire de continuer à investir dans les économies des trois pays, mais le climat d'investissement se détériore en raison de la menace terroriste.
Les difficultés économiques peuvent être surmontées par des efforts conjoints. Les débuts confédéraux de l'AES sont l'occasion d'entamer le processus d'intégration économique. Les pays du Sahel cherchent à établir une union économique et monétaire qui aboutira à une nouvelle monnaie appelée le Sahel. La suite logique de ces actions pourrait être la sortie de la zone franc.
Ainsi, le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO pourrait stabiliser la situation politique des pays du Sahel en raison du soutien massif au taux de change AES, tandis que les projets de création d'une monnaie unique et de sortie de la zone franc pourraient renforcer l'indépendance économique des trois pays.
L'évolution de l'ordre régional en Afrique de l'Ouest
Depuis près d'un siècle et demi, l'Afrique de l'Ouest fait partie de la zone d'influence française. Depuis que les troupes françaises ont établi leur contrôle sur ces terres, tous les processus politiques et socio-économiques de la région se sont déroulés avec la participation directe de la France. Toutefois, au cours des dernières années, la France a considérablement perdu son influence en Afrique de l'Ouest. L'échec de l'opération antiterroriste « Barkhan » au Mali, qui a contraint la France à retirer ses troupes du pays, a marqué un tournant. Après une série de coups d'État militaires au Sahel, en grande partie anti-français, la position de Paris s'est encore affaiblie. Les troupes françaises quittent le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Tchad et le Sénégal. Le coup de grâce est donné par le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO et la création de la Confédération des États du Sahel. Cette situation était particulièrement dangereuse pour la France, car la SEA représentait une alternative de développement pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la CEDEAO pro-française qui agit comme un groupement intégrationniste en Afrique de l'Ouest, mais aussi l'AES. Le Tchad tente déjà un rapprochement avec les pays de l'AES. Les 21 et 22 février 2025, le président tchadien Mahamat Déby a assisté au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Par ailleurs, le chef de l'État centrafricain a rencontré son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Au cours de ce dialogue, les deux parties ont discuté de la lutte contre le néocolonialisme et des défis sécuritaires dans la région. Le journal français Le Monde y voit un possible rapprochement entre le Tchad et l'AES.
Bien que le Ghana agisse davantage comme un intermédiaire dans les négociations entre l'AES et la CEDEAO, il a également tenté de se rapprocher des pays de l'AES. Ainsi, le président John Dramani Mahama a visité les pays de l'AES du 8 au 10 mars 2025. Au cours de sa visite, il a discuté avec les chefs d'État du renforcement de la coopération bilatérale et des questions de sécurité au Sahel.
L'autorité de l'AES en Afrique s'accroît progressivement, ce qui pourrait inciter certains pays de la région à se rapprocher de la Confédération. Le 29 janvier 2025, de nouveaux passeports du SEA ont été introduits et le drapeau de la Confédération des États du Sahel a été approuvé le 22 février. Toutes ces mesures devraient contribuer à renforcer la position de l'organisation dans la région.
La France, mais aussi les États-Unis, sont en train de perdre leurs anciennes positions régionales. En 2012, des troupes américaines ont été envoyées au Niger pour lutter contre le terrorisme, mais après le coup d'État de 2023 au Niger, les militaires arrivés au pouvoir ont exigé que Washington retire son contingent militaire du pays. Les États-Unis ont dû faire des concessions. Au début du mois d'août 2024, tout le personnel militaire américain a été retiré du Niger et les bases militaires ont été placées sous le contrôle des armées locales.
La Russie est l'un des acteurs dont les positions régionales se renforcent. Moscou a été particulièrement active dans sa coopération avec le Mali. Depuis son accession à l'indépendance en 1960, la République a signé un certain nombre d'accords économiques importants avec l'URSS et, après son effondrement en 1991, avec la Russie. Au stade actuel des relations russo-maliennes, le champ de la coopération s'est considérablement élargi : il couvre également les domaines militaire et politique. Ainsi, un accord de coopération militaro-technique a été signé en 2003, en 2009 un mémorandum sur la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, et en 2019 un accord intergouvernemental sur la coopération militaire.
La Russie peut être considérée comme le principal partenaire du trio sahélien. Elle a ainsi soutenu l'initiative de création d'une Confédération des États du Sahel. Fin décembre 2024, l'ambassadeur de Russie au Mali Igor Gromyko a déclaré que la Russie confirme son intention de continuer à fournir le soutien nécessaire aux pays de l'Alliance des États du Sahel, y compris l'aide à l'amélioration de l'efficacité au combat des forces armées nationales, la formation du personnel militaire et des forces de l'ordre, ainsi que de développer une coopération commerciale et économique mutuellement bénéfique avec ces États, et a ajouté que la création de l'AES est une étape importante dans la lutte contre le terrorisme dans la région. C'est pour la mise en œuvre de ces tâches que le Corps africain relevant du ministère russe de la défense a été créé à la fin de 2023 sur la base de la société militaire privée Wagner, qui vise à lutter contre le terrorisme dans la région. Il s'agit d'une étape importante vers la consolidation de la position de la Russie en Afrique de l'Ouest.
La Russie écarte progressivement la France du Sahel, ce qui s'exprime non seulement dans la sphère politico-militaire, mais aussi sur le plan économique. La Fédération de Russie a signé un certain nombre d'accords économiques et commerciaux avec les pays de l'AES, ce qui a gravement affecté les sociétés et les entreprises françaises au Sahel. Le coup le plus douloureux a sans doute été l'interdiction faite à la société française Orano d'exploiter l'uranium au Niger, l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde. Pour la France, le minerai d'uranium du Niger alimentait un certain nombre de centrales nucléaires. Depuis, des sociétés russes ont été invitées à exploiter des mines au Niger, dont la société française Orano, l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde.
Pour la France, le minerai d'uranium du Niger a alimenté plusieurs centrales nucléaires. Depuis, des entreprises russes ont été invitées à exploiter des minerais au Niger, dont l'uranium. Fin février 2025, les deux pays ont signé un protocole d'accord sur l'exploration et l'exploitation minière, qui prévoit le développement d'une coopération bilatérale pour renforcer l'exploration minière et le potentiel minier du Niger.
La Chine accroît également son influence dans la région. Selon le China Global Investment Tracker, les investissements directs chinois au Mali se sont élevés à 600 millions de dollars en 2023-2024 et à 700 millions de dollars au Niger. Ils étaient principalement dirigés vers les secteurs métallurgique et pétrolier, ainsi que vers l'énergie nucléaire. La coopération militaire occupe une place importante dans les relations de la Chine avec les pays du Sahel. Ainsi, en juillet 2023, on apprenait la signature d'un contrat de fourniture d'armes chinoises au Niger pour un montant de 4,2 millions de dollars. Bien qu'il s'agisse principalement d'armes légères (fusils, mitrailleuses, lance-grenades, systèmes de roquettes, etc.), le fait qu'il existe un accord de défense renforce considérablement l'autorité de la Chine dans la région.
La Turquie est un autre acteur qui a accru son influence au Sahel. Ankara met l'accent sur la coopération militaire avec les pays de l'AES. Ainsi, en 2022, les forces armées maliennes ont reçu des drones Bayraktar TB2, qui doivent être utilisés dans la lutte contre le terrorisme dans la région.
Le forum diplomatique qui s'est tenu à Antalya du 1er au 3 mars 2024 a mis en exergue les problèmes de la région du Sahel. Le forum a vu la participation de représentants des pays de l'AES qui ont critiqué la CEDEAO. En particulier, le ministre des affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a déclaré que la CEDEAO ne répondait pas de manière adéquate aux problèmes régionaux et qu'elle n'avait pas réagi aux crises dans la région, tout en s'opposant à la nouvelle politique étrangère des pays du Sahel. En outre, le ministre a noté que les sanctions sévères imposées aux pays de l'AES n'avaient aucune base juridique, alors que la coopération dans le cadre de l'AES semblait être une solution aux problèmes régionaux.
***
Le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO a entraîné une transformation de l'ordre régional en Afrique de l'Ouest : une alternative à la CEDEAO a vu le jour sous la forme de la Confédération des États du Sahel. L'AES n'a pas les mêmes capacités que la CEDEAO, mais elle se développe rapidement. Certains pays manifestent déjà de l'intérêt pour l'AES. Les projets d'intégration économique ne feront que renforcer la position de l'organisation, ce qui amènera l'AES à concurrencer la CEDEAO. Il reste à voir si cette concurrence se transformera en confrontation.
De son côté, la Russie, en soutenant les militaires arrivés au pouvoir à la suite de coups d'État, écarte progressivement la France de la région. Il s'agit là d'un sérieux défi pour la politique étrangère française, qui sera extrêmement difficile à relever, du moins sur le moyen terme. Le vide politique créé par le retrait de la France et des États-Unis du Sahel a été comblé non seulement par la Russie, mais aussi par la Chine et la Turquie. Ces pays consolident de plus en plus leur influence dans la région et cherchent à accéder aux ressources.
Les forces armées des trois pays sont régulièrement la cible d'attaques islamistes et séparatistes. La menace des groupes djihadistes s'accroît. Afin de stabiliser définitivement l'ordre régional établi, il est nécessaire de détruire les cellules terroristes et séparatistes qui menacent les régimes actuels des pays de l'AES, ce qui déterminera la stabilisation politique dans les trois pays et le développement de projets socio-économiques. Les pays du Sahel sont susceptibles de poursuivre leurs efforts de coopération dans la lutte contre le terrorisme et d'étendre leur coopération en matière de défense avec la Russie, la Turquie et la Chine.
First published in :

Étudiant en maîtrise à la Faculté de politique mondiale de l'Université d'État de Moscou.

Étudiant en maîtrise à la Faculté de politique mondiale de l'Université d'État de Moscou.
Unlock articles by signing up or logging in.
Become a member for unrestricted reading!